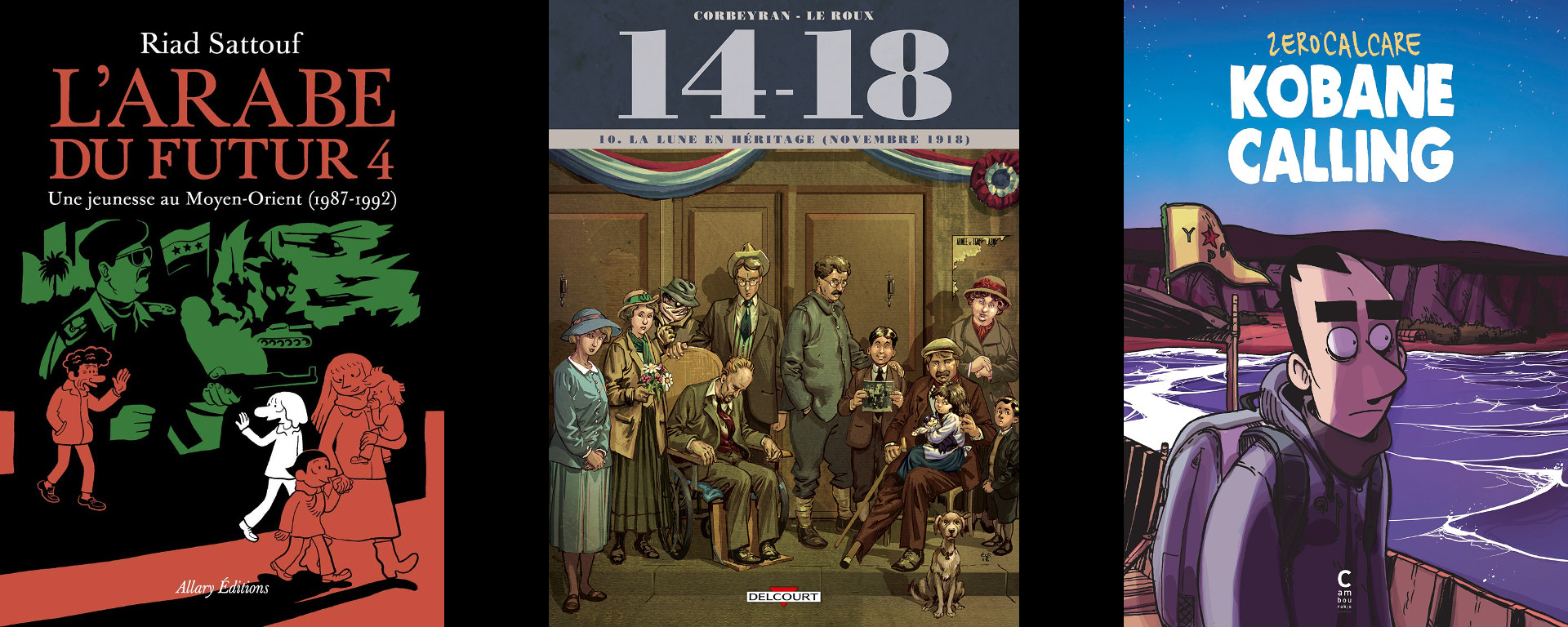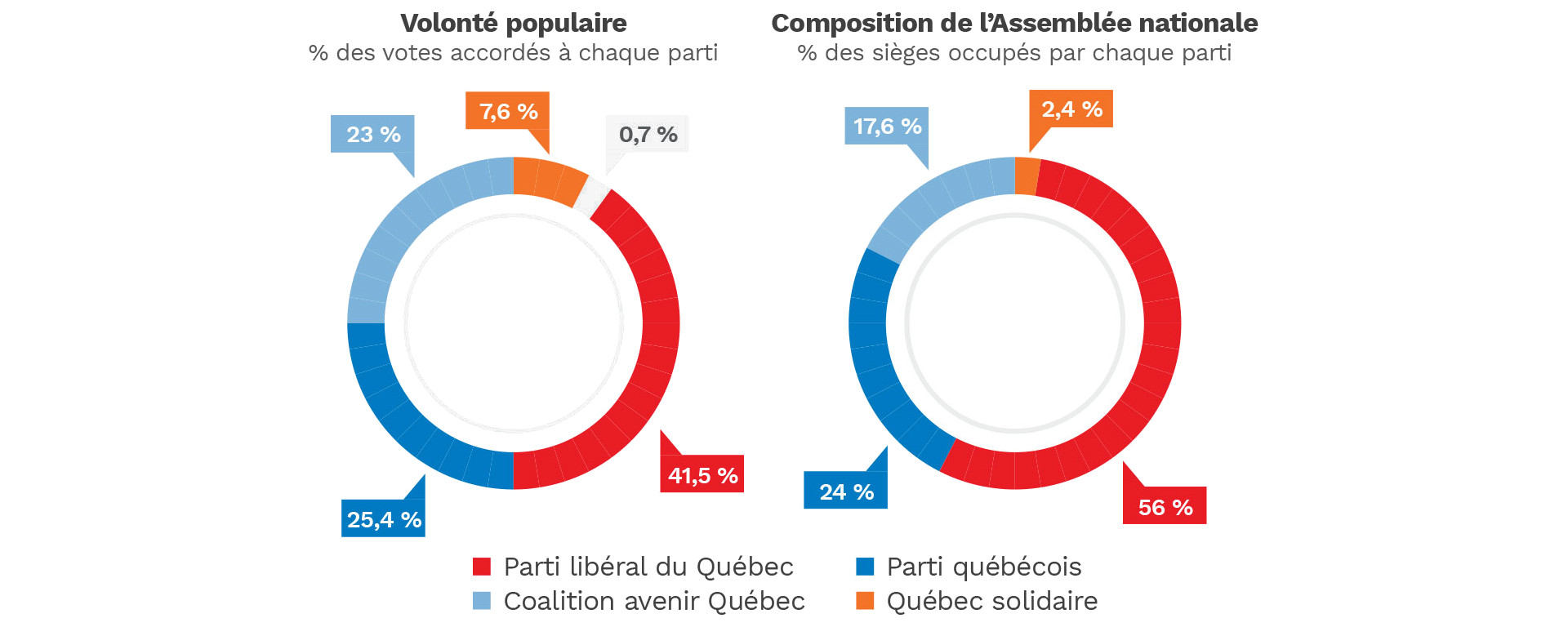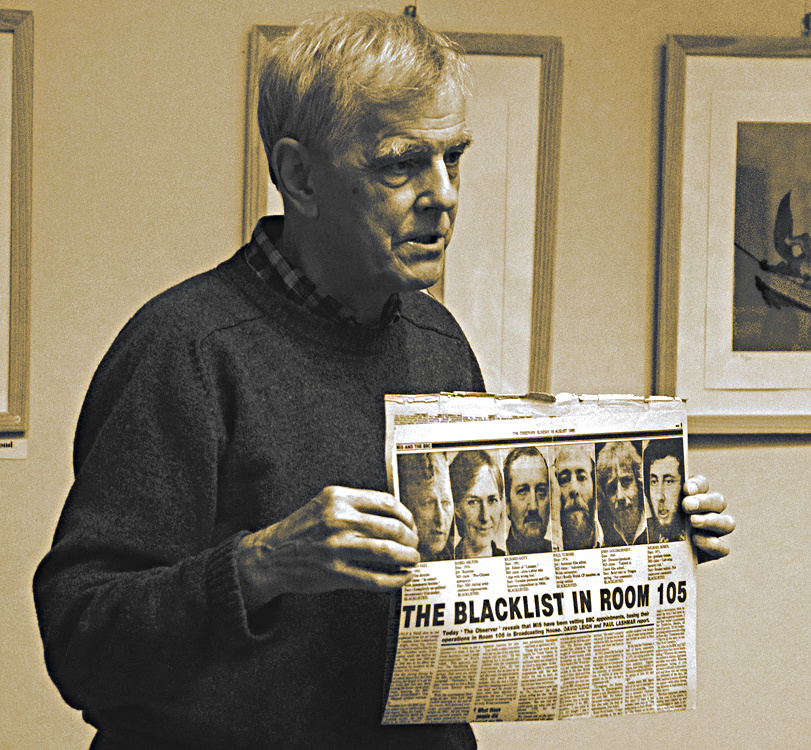Deux universitaires qui veulent «changer le monde», cela donne la ferme maraichère La Joual Vert à Cookshire-Eaton. Laurie Bush et Pierre-Antoine Jacques ont décidé de mettre les mains dans la terre pour nourrir leur communauté. Entretien avec Pierre-Antoine sur le sens et les défis de ce choix de vie.
Entrée Libre: Comment a été créée la ferme de la Joual Vert?
Pierre-Antoine: nous avons racheté l’entreprise qui exploitait déjà les terres que l’on cultive. Nous avons donc créé une nouvelle entreprise mais à toute fin pratique pour la clientèle cela n’a rien changé. Cette ferme existait depuis 2 ans sur le site actuel de Cookshire et ils ont décidé de vendre. Ça a été pour nous une occasion en or car ça n’arrive pas souvent que des petites entreprises comme ça soit à vendre. Le problème au Québec généralement c’est la taille des terres agricoles. Donc de trouver des entreprises abordables à moins de 100000$, c’est pas évident. On possède le matériel comme les serres et le matériel roulant, puis on loue une parcelle de terrain et des droits d’accès à des espaces de rangement. Nous avons fait un emprunt avec la financière agricole du Québec, qui est une institution provinciale qui garantit les prêts auprès des institutions financières. Puis nous on a mis chacun une mise de fonds de base pour acheter tout ça. On a un terme de 7 ans pour rembourser notre prêt. La financière agricole elle est vraiment là pour soutenir les agriculteurs. Elle offre même un congé de remboursement de capital pendant un certain temps suivant si ça va bien ou pas.
Entrée Libre: Maintenant que la saison se termine, quel est le bilan de votre 1ère année d’exploitation?
Ça a été très difficile (rires)! Sur beaucoup d’aspects. Dans ce métier on est à la merci de la météo et le printemps a été un peu lent à s’installer donc la chaleur était tardive et ça a chamboulé notre plan de production. Ça fait 4 ans que je travaille avec des serres, mais il n’empêche que changer de site c’est tout un nouvel apprentissage. S’habituer au site c’est quelque chose de complexe: par exemple on avait un problème de mauvaise herbe, le galinsoga, qui est assez difficile à éradiquer. Je n’avais jamais rencontré cette mauvaise herbe dans le passé et je n’avais jamais imaginé que ça serait aussi problématique. C’est sûr qu’en régie biologique les solutions sont plus difficiles: on a recours au sarclage manuel, et ça pose son lot de défis. Mais c’est un choix que l’on fait de ne pas avoir recours aux produits chimiques.
Qu’est-ce que ça fait un maraicher en hiver?
Ca fait toutes sortes de jobines! Parce que pour produire en hiver c’est possible, mais les couts de chauffage sont prohibitifs. À tout le moins les investissements nécessaires pour avoir des systèmes qui sont très performants au niveau du chauffage comme la géothermie ben y’a peu de fermes qui peuvent se le payer. Mais l’enjeu (en hiver) ce n’est pas tellement la température: il fait froid mais il y a aussi un manque de lumière et donc la courbe de croissance est ralentie. Donc un maraicher ca travaille moins l’hiver, ça en profite pour faire de la plano, pour réparer le matériel, faire tout ce qu’on n’a pas eu le temps de faire pendant la saison. Mais généralement, il faut se trouver un autre petit emploi. Mais le but c’est aussi de se tirer suffisamment de revenus pour prendre congés pendant la saison hivernale, parce qu’on se le cachera pas c’est très très exigeant physiquement et que c’est bien important d’avoir un moment de repos, prendre le temps de recharger les batteries.
Tu étais étudiant à Montréal, puis tu viens t’installer sur une ferme en Estrie. Quel est ton parcours?
En fait je viens de Sherbrooke, j’ai grandi et étudié là puis à l’université je suis allé brièvement à Montréal pendant 2 ans. J’étudiais en Sciences Politiques à l’UQAM. Ça a été une période difficile pour moi l’université, une période de remise en question à savoir ce que je voulais faire dans la vie. Puis curieusement moi je ne suis pas issus du monde agricole, mais c’est à l’université, à Montréal, que j’ai eu un flash sur le maraichage. J’avais un cours en sciences politiques sur les mouvements sociaux puis y’en a un qui traitait de l’agriculture urbaine et de l’implication citoyenne à travers ce mouvement-là. C’est à ce moment que j’ai accroché. Au début, l’agriculture urbaine je trouvais ça super intéressant, mais plus tard j’en ai vu les limites pour en faire un métier car c’est un circuit à plus petite échelle donc je me suis tourné vers le maraichage plus intensif.
Donc tu avais déjà travaillé dans le maraichage avant de reprendre la Joual Vert?
Oui, parce qu’après l’université j’ai loué une terre sur la rive sud à 30 minutes de Montréal, et c’est là que j’ai fait mes premières expériences agricoles.
Sans formation, sans rien?
Non, autodidacte! J’ai mordu la poussière plusieurs fois, mais on apprend vite. Un des désavantages d’être autodidacte c’est que c’est très difficile, qu’on avance à tâtons, mais comme on est tout le temps un peu dans la merde, on n’a pas le choix d’apprendre vite (rires)! C’est du courage ou de la naïveté.
Sur la page web de la Joual Vert tu écris: «Faire ce métier, c’est relever le défi de tracer un nouveau visage à l’agriculture». Tu peux expliquer à quoi ressemble ce nouveau visage?
Le choix de ce travail là, c’est aussi l’aboutissement d’une réflexion à savoir comment mon action politique allait s’incarner dans la vie de tous les jours. Quand j’étais à l’université c’était un enjeu: tout devenait politique pour moi et à un moment donné c’était très très lourd à porter. Je cherchais une manière d’incarner un certain changement dans la vie. Pour moi ça à fait beaucoup de sens d’occuper un emploi qui avait un impact vraiment positif sur l’environnement, qui est une forte préoccupation pour moi, ça a comme était une révélation. C’est un métier qui fait du sens pour moi parce que j’ai une réalisation concrète à la fin de la saison: j’ai réellement fait pousser des légumes. Je fais ça puis je vois l’impact aussi: quand tu vas au supermarché puis que tu vois tes tomates qui viennent du Mexique alors que tu sais que tu es tout à fait capable d’en faire pousser ici au Québec, ben l’impact est facile à réaliser. Je trouver ca important que ce type de fermes là se multiplient au Québec parce qu’il n’y en a pas assez. C’est dire qu’il y a encore trop de tomates du Mexique sur nos étals. Il devrait y avoir des tomates du Québec partout, à tout le moins en pleine saison, ça devrait être la norme.
Un nouveau visage à l’agriculture, c’est peut-être de faire partie de cette nouvelle génération là d’agriculteur qui essaye de contribuer à offrir des produits locaux aux québécois.
Qu’est-ce que tu appelles être un «fermier de familles»?
C’est une expression qui a été popularisée par le Réseau ÉquiTerre pour promouvoir l’agriculture soutenue par la communauté. Tout le principe classique de la formule des paniers, de paiement à l’avance au début de la saison pour donner une avance aux producteurs pour qu’ils puissent payer leurs intrants, leurs semences, puis produire pendant un nombre défini de semaines. Donc là l’idée derrière tout ça c’est vraiment de développer un lien privilégié avec le client. Donc là on ne devient pas juste des agriculteurs anonymes dont on ne connaît pas les visages quand on achète les produits sur les rayons des supermarchés. C’est vraiment de développer un lien, de savoir que l’on nourrit telle famille, que telle famille nous soutient. À un moment donné de prendre acte de leurs préférences aussi de ce qu’ils veulent. Donc moi je trouve ca intéressant quand je suis au marché et que quelqu’un me dit « moi j’aime tellement tel truc, en avez-vous? » et là tu te dis « ah merde j’en ai pas », et cette personne-là elle me fait confiance alors ça va me faire plaisir, ça va être un honneur de mettre une note à mon calendrier de production puis de lui en produire. C’est là que ça devient plus qu’un rapport marchant.
Ça veut dire quoi «l’autonomie alimentaire»? Concrètement ça passe par quoi pour une région comme l’Estrie ou une ville comme Sherbrooke?
L’autonomie alimentaire c’est très très large. On ne sera jamais en mesure de tout produire, ça c’est bien entendu. Mais là où on espère opérer un changement c’est que les gens réalisent que c’est tout à fait possible de consommer de manière local le plus possible. Cette autonomie alimentaire là, ça passe pas nécessairement par devenir tous des agriculteurs, même si j’encourage tout le monde à mettre ses mains dans la terre dans un petit jardin personnel, mais c’est pas un prérequis. Cela dit, on a tellement de ressources, de bonnes terres agricoles en Estrie et au Québec en général, que je pense que c’est tout à fait possible de produire probablement 100% de notre production végétale ici (en Estrie). Les légumes, les céréales, le lait, la viande… La majorité on est capable de le produire. Et si on se forçait réellement, on serait probablement capable de tout produire ca même en hiver, ou à tout le moins planifier les récoltes pour avoir des surplus de conservation pour passer tout l’hiver. Mais une chose est certaine: en Estrie pour un maraicher, tout est possible, ça c’est clair! C’est une question de volonté politique et d’habitudes de consommation, et peut être d’éducation aussi. Manger local, 12 mois par année au Québec, c’est possible, c’est pas une utopie.
Pour conclure, une idée cuisine pour un légume d’automne?
Évidement l’automne c’est la saison des courges, moi j’encourage les gens à lâcher les butternuts et lâcher les spaghettis. C’est les deux courges les plus populaires, et puis il en existe tellement d’autre sortes qui sont fascinantes, qui sont super bonnes. Moi par exemple ma préférée c’est la red kuri (ou potimaron). Personne la connait! Tout le monde la trouve belle au marché parce qu’elle est orange mais on la trouve jamais nulle part au supermarché. C’est une courge orange-rouge et en forme de poire. Je trouve la chaire super sucrée. Je la fais en cubes. Par exemple coupée en cubes avec carry et cannelle dans la poêle et l’accompagnement c’est un peu au choix.
Un légume que j’ai découvert, mais c’est plus en été, c’est les pâtissons. Ça a été cette année mon pire flop au niveau des ventes, j’en vendais jamais jamais jamais! C’est dans la même famille que les courgettes, au lieu d’être allongés ça ressemble à une soucoupe volante. C’est aplati, ça a des rebords dentelés, c’est vraiment cent fois meilleur qu’une courgette, c’est moins gorgé d’eau, c’est plus gouteux, ça goute un peu comme le beurre. Moi pour vrai entre des pâtissons puis des courgettes je prends des pâtissons n’importe quand! Puis ça se cuisine comme la courgette: en tranche, sur le BBQ, dans la pizza, poilé dans du beurre, peu importe. Mais personne ne connait les pâtissons: j’ai dû en passer un ou deux dans toute la saison, et tous ceux qui en ont acheté et l’ont cuisiné m’ont dit « au mon Dieu c’est tellement meilleur que les courgettes » mais c’est une question d’habitude: on n’en trouve jamais au supermarché. On trouve toujours les courgettes vertes, les pâtissons jamais jamais jamais, donc les gens ne connaissent pas ca…