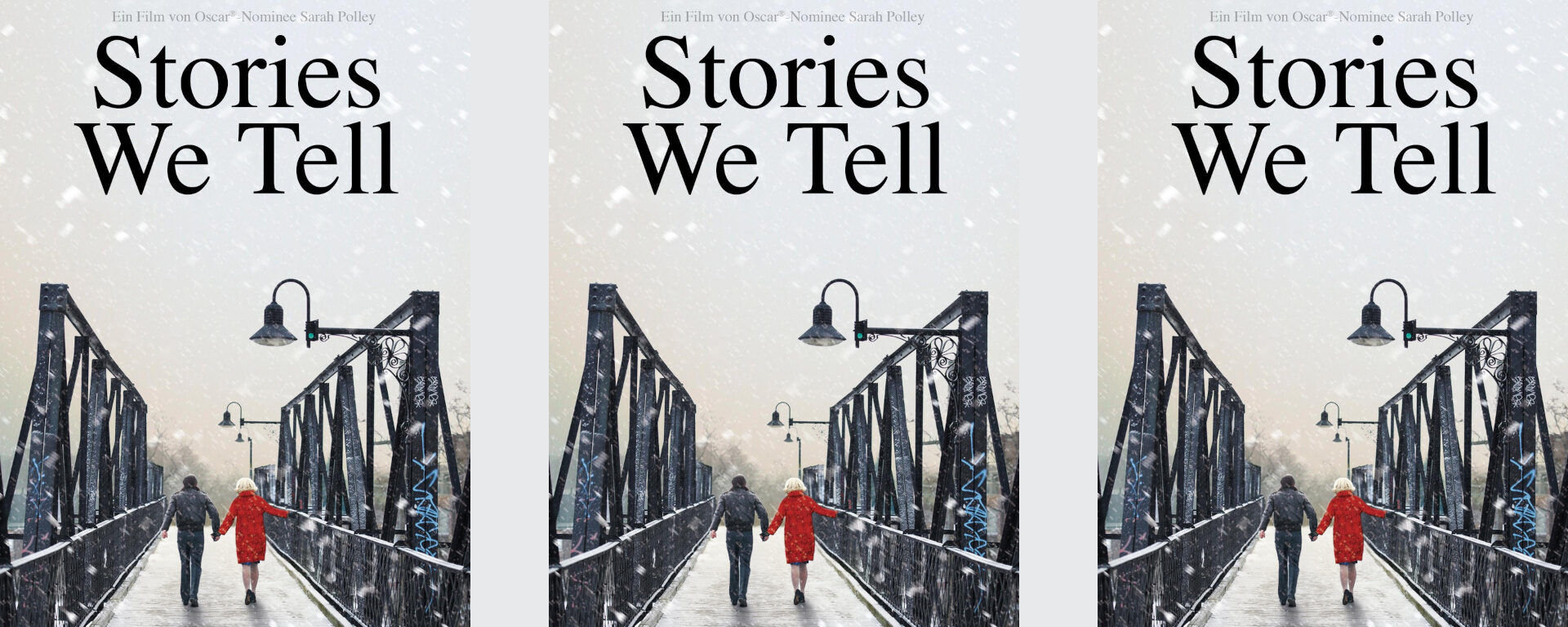Je réfléchissais à écrire une critique sur Everybody want some de Richard Linklater. Dans le processus d’écriture, je me suis finalement rendu compte que je ne sais pas parler de cinéma. Alors que le film décantait en moi, je cherchais à expliquer l’effet qu’il eut, ce léger bouleversement existentiel qu’il soulevât, en vain.
Je pourrais parler de son sujet : Jake Bradford, nouvel arrivant à l’université et sélectionné comme receveur dans l’équipe universitaire de baseball, emménage dans la maison de l’équipe deux jours avant le début des cours. On le suivra lui et ses coéquipiers passer le temps avant le début de la session alors qu’ils n’ont qu’une chose en tête : Le baseball et la baise. Derrière cette ribambelle de personnages tous plus douchebag les uns que les autres se cachent des individualités propres. Linklater, comme à son habitude, réalise un film dont la narration est basée uniquement sur l’évolution de ses personnages. On se retrouve à suivre leur quête de soi, se demander qui ils sont et qui ils vont devenir alors qu’ils sont à un carrefour important de leur vie, un sujet sobrement résumé par une phrase du film : « ’look at us, man. The last three nights we’ve danced at a disco […]. Danced to cotton eyed joe in kicker attire, and here we are punks for a night! Sort of beg the question of who we really are ». En résulte une comédie qui maintient l’équilibre difficile entre légèreté grivoise et réflexion profonde.
Je pourrais, comme l’a théorisé Truffaut, parler de son auteur : Richard Linklater. Analyser le film à l’aune de sa filmographie. Mentionner que le passage du temps est une thématique centrale de sa carrière, et que peu en ont parlé aussi bien que lui. Dans la trilogie du Before, il explore une relation amoureuse s’étalant sur 18 ans, à l’écran comme dans la vie. Dans Boyhood il étale sur 12 ans devant nos yeux le passage à l’âge adulte d’un jeune garçon. Si Everybody want some est plus modeste, loin de telles prouesses de production, sa temporalité n’en est pas moins singulière. Deux jours de flottement avant le début de l’université comme si le film existait hors du temps pour ses personnages, comme pour le spectateur.
Je pourrais parler purement technique, et m’attarder sur la combinaison d’écriture et de jeu d’acteur qui suffisent à rendre des scènes de dialogues d’une dizaine de minutes captivantes de bout en bout, même quand cela consiste à d’expliquer pourquoi parler aux femmes de son petit pénis est une excellente technique de drague.
Toutes ces analyses, si elle arrive à expliquer pourquoi Everybody Want Some est un bon film, ne semblent pas suffire. Pourquoi suis-je resté les yeux rivés au plafond, à réfléchir sur ma propre existence, après avoir vu un film sur une bande de douchebag qui jouent au baseball ? Pourquoi je n’arrive pas à expliquer pourquoi une œuvre me transporte ? Existe-t-il un syndrome de Stendhal pour le cinéma ? Résonnaient en moi ces mots de Bergman : « I’m not trying to make it real, i’m trying to make it alive ». Il est vrai que certaines œuvres sont vivantes, je ne serais pas expliquée, par quelle alchimie cela est possible. Peut-être que certains films, viennent nous chercher au bon moment, au bon endroit, mais cette justification relativiste me semblait bien légère ? La nature ineffable de ce sentiment me fut intolérable. La conclusion était irrévocable : je ne sais pas parler de cinéma.
Des mois passèrent, la frustration demeura.
C’est d’un autre film que vint le déclic : Verdens verste menneske (The worst person in the world) de Joachim Trier. Comédie romantique norvégienne qui valut le prix d’interprétation féminine à Cannes pour son actrice Renate Reinsve. Le film nous fait naviguer dans 4 années de la vie de Julie (Renate Reinsve) qui ne sait pas très bien où elle va dans sa vie professionnelle comme en amour. On suit une jeune femme naviguer à travers ses doutes, se demander qui elle est, refusant comme elle le dit si bien d’être « spectatrice de sa propre vie ». L’écriture impeccable de Trier et son coscénariste Eskil Vogt construit un film d’une justesse impeccable, au rythme irrégulier : souvent comique, parfois plongeant dans des abimes mélancoliques.
Mais c’est au détour d’une scène magnifique où Julie court dans les rues d’Oslo, alors que le reste de la ville est figé dans le temps, que j’ai compris. Des plans similaires, traveling de profil de personnages en train de courir, me sont revenus en tête. J’ai revu Jean Pierre Leaud fuyant la misère dans les 400 coups, Greta Gerwig dansant sur du David Bowie dans les rues de New York dans Frances Ha !, Michael Fassbender faisant son jogging sous une musique mélancolique dans Shame, Cooper Hoffman et Alana Haim courant l’un vers l’autre transit d’amour dans Licorice Pizza. Ce plan, d’une minute tout au plus, venait de me percuter de la beauté de tous ceux qui l’ont précédé. Il avait accompli ce que je n’arrivais pas : il avait exprimé l’inexprimable, communiqué l’ineffable. Lorsque je pense à un film, je ne pense pas à ces dialogues, je ne pense à son histoire, je pense à ses plans. Je visualise la scène dans mon esprit, dans son entièreté avec tout ce qui la compose : son cadrage, son montage, ses acteurs, ses mouvements de caméra. Une beauté qui n’existe que par l’agencement complexe de toutes ses parts et qu’aucun mot ne serait décrire. Quand je pense à la beauté de The worst person in the world, je vois Renate Reinsve dans un grand trench noir, marchant avec les larmes discrètes de celle qui se demande quelle direction prend sa vie. Je vois l’alternance de plan serré et de plan large, montrant tour à tour son visage meurtri de chagrin et Oslo, magnifique sous un ciel crépusculaire presque rose. Je vois cet étalonnage légèrement désaturé si caractéristique du cinéma scandinave, ou l’omniprésence de couleurs froides fait ressortir la moindre once de chaleur. Le film qui joue alors dans ma tête sera toujours plus fort que les mots écrits sur cette page. Un jour, je verrais un autre film, une scène similaire, un cadrage identique, et je repenserais à Julie dans les rues d’Oslo. Consciemment ou pas, un cinéaste déverse dans son art les influences qui l’ont construite. On dit souvent, à raison, que tous les films parlent de cinéma… Peut-être qu’il n’y a que les films qui savent parler de cinéma.
En attendant, je vous conseille ces deux films en espérant qu’ils vous trouvent, au bon moment, au bon endroit et peut-être qu’un jour j’arriverai à parler de cinéma.